Justin Barrett : les bébés sont des croyants-nés
Les recherches du professeur Justin Barrett (Université d'Oxford) confirment que tous les bébés naissent croyants. Ils ont la capacité innée de croire en un Dieu unique, mais aussi d'être créés dans un but particulier, quand bien même leur environnement ne serait pas religieux. Par conséquent, "si nous envoyons un bébé sur une île déserte, il croira en Dieu". De la même manière que Wolfgang Amadeus Mozart était un "musicien né", exprimant son génie "comme par l'opération du Saint-Esprit" dès son plus jeune âge.
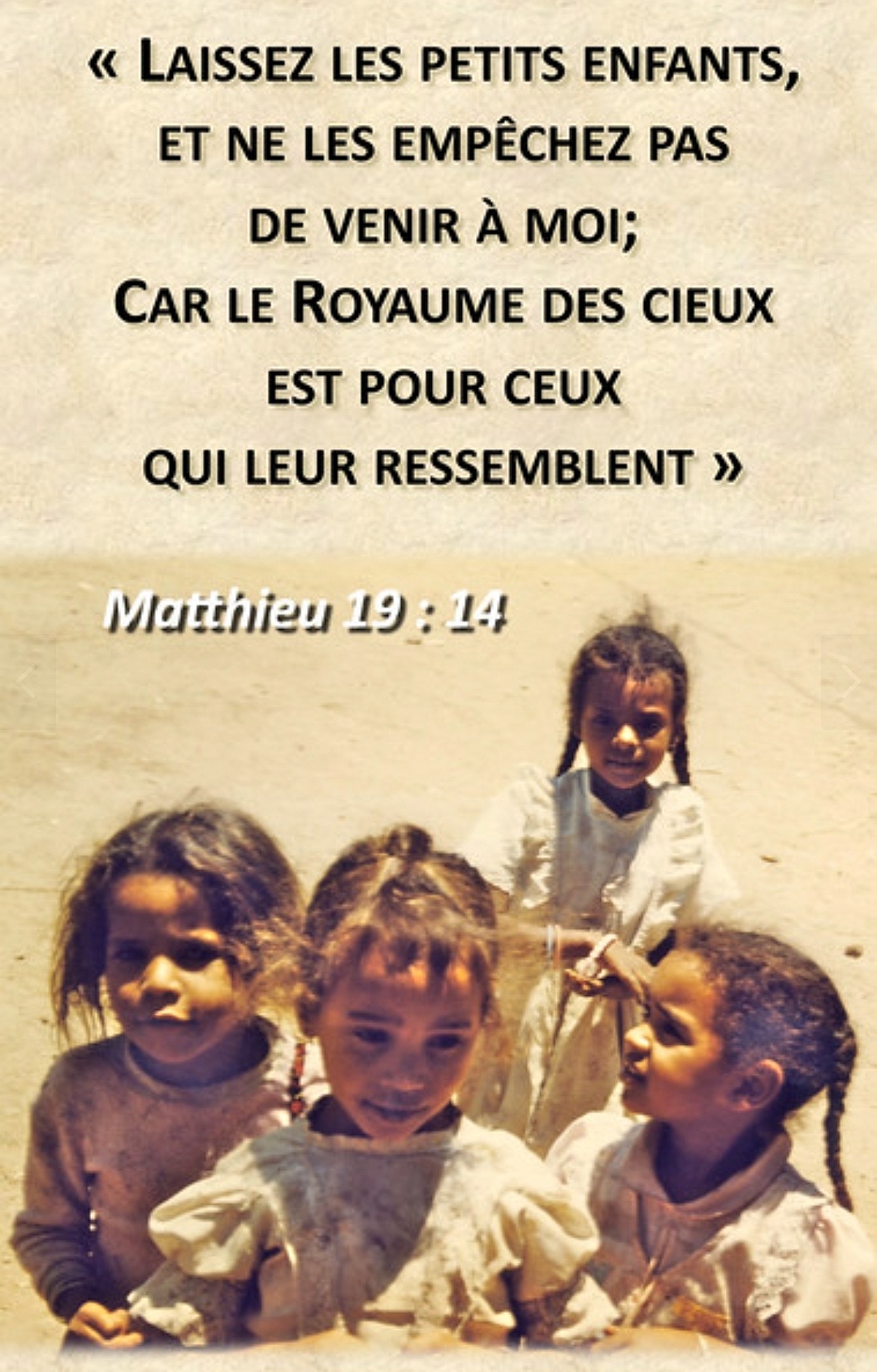
Docteur en psychologie expérimentale de l'Université Cornell, Justin L. Barrett a été professeur de sciences du développement et professeur de psychologie à la Fuller Graduate School of Psychology. Auparavant, il était chercheur principal et directeur du Centre d'anthropologie et d'esprit de l'Institut d'anthropologie cognitive et évolutive de l'Université d'Oxford. Il a également travaillé dans les facultés de psychologie du Calvin College et de l'Université du Michigan (Ann Arbor), et en tant que chercheur à l'Institut de recherche sociale. Il est actuellement le rédacteur en chef fondateur du Journal of Cognition & Culture et est l'auteur de nombreux articles et chapitres concernant la science cognitive de la religion.
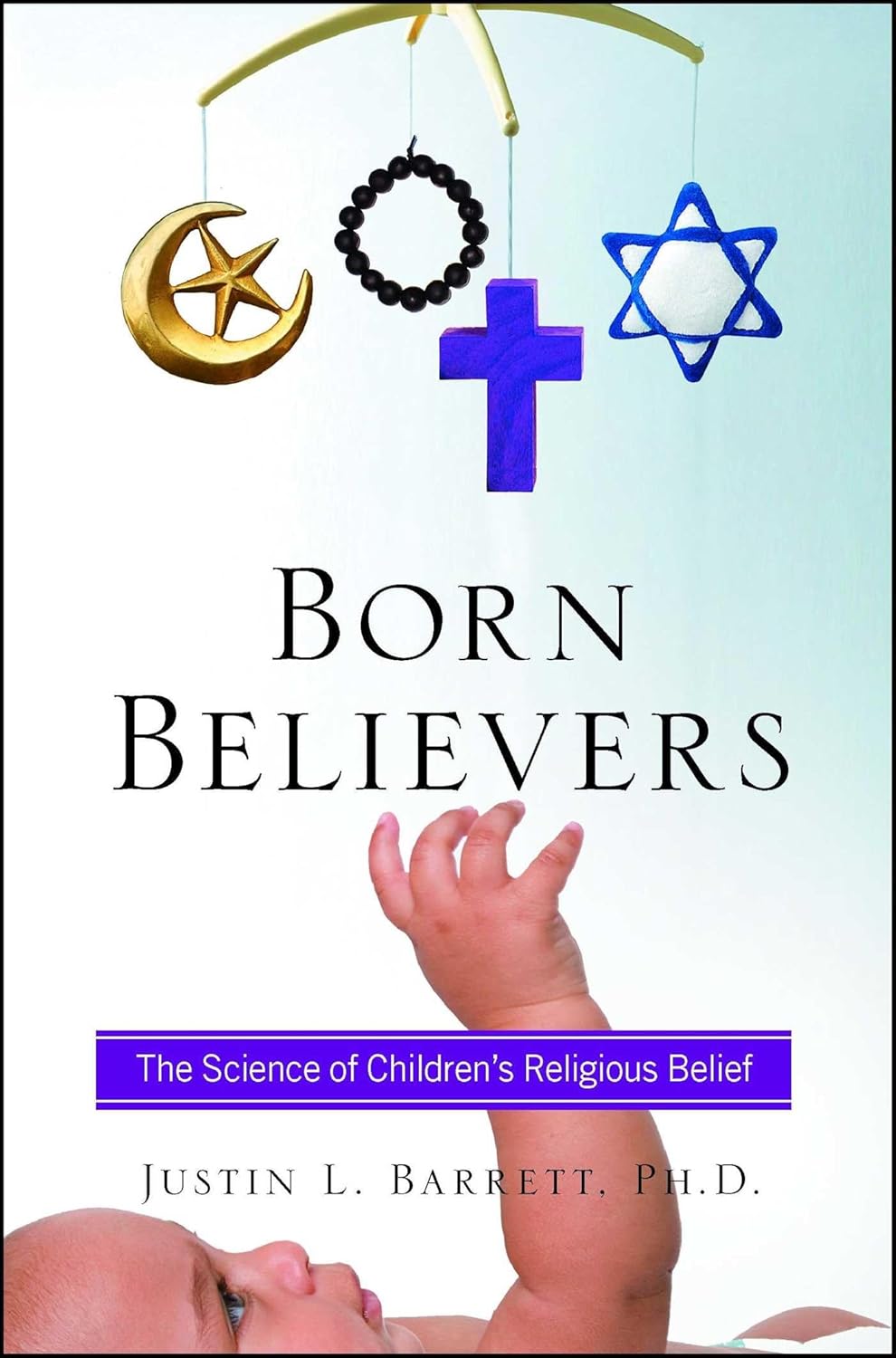
L'idée générale n'est pas nouvelle : le Daily Mail titrait déjà le 13 mai 2011 que La croyance en la religion est "simplement une partie universelle de la nature humaine", c'est à dire que les humains sont enclins naturellement à croire aux dieux et à l'au-delà. Résultat d'un projet international de 1,9 million de livres sterling, impliquant 57 chercheurs dans des disciplines variées comme l'anthropologie, la psychologie et la philosophie, et dirigés par des universitaires de l'Université d'Oxford dans plus de 40 études. La pensée humaine est donc "enracinée" dans des concepts religieux, lesquels ne sont pas pas acquis. Les personnes ayant des croyances religieuses sont également plus susceptibles de coopérer dans le cadre des sociétés, alors que les personnes vivant dans des villes de pays prospères, dotés de réseaux sociaux solides, sont moins susceptibles de suivre la religion.
Le professeur Roger Trigg, de l'Université d'Oxford et codirecteur du projet, déclarait : «La religion n'est pas simplement quelque chose de singulier que nous pratiquons le dimanche au lieu de jouer au golf». (...) C'est pourquoi «les tentatives de supprimer la religion sont éphémères, puisque la pensée humaine semble profondément liée aux concepts religieux, comme l'existence d'êtres surnaturels, et la possibilité d'une vie après la mort. (...) Nous avons rassemblé un ensemble de preuves qui suggèrent que la religion est un fait commun de la nature humaine dans les différentes sociétés. (...) Nous avons tendance à voir un but dans le monde. (...) Nous pensons qu'il y a quelque chose même si nous ne pouvons pas le voir... Tout cela concourt à créer un mode de pensée religieux.»
Des expériences distinctes en Chine et à Belfast ont confirmé que des personnes de diverses cultures croient qu'une partie de leur esprit, de leur âme ou de leur esprit vit après la mort. D'autres recherches, de l'Université Tsinghua en Chine et de l'Université Queen's, Belfast, ont suggéré que les différences culturelles ne sont pas un obstacle à la croyance, qu'une partie de l'âme ou de l'esprit vit après la mort. Les résultats ont été publiés dans deux livres du Dr Justin Barrett : Cognitive Science, Religion And Theology et Born Believers : The Science Of Childhood Religion.
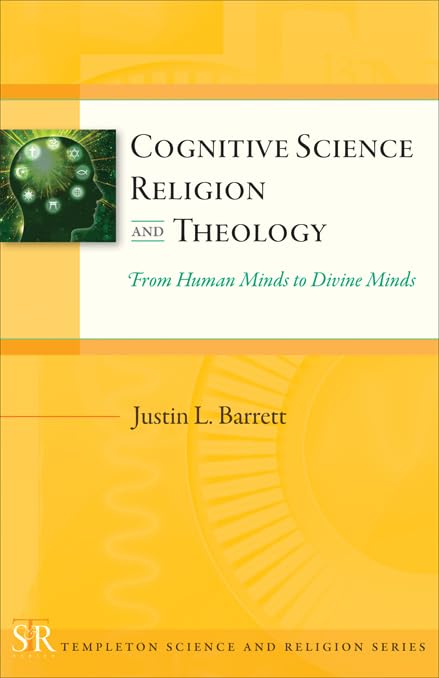
Le Dr Justin Barrett, alors au Centre d'anthropologie et d'esprit de l'Université d'Oxford, déclarait : "Ce projet ne veut pas prouver l'existence de Dieu ou des dieux. (...) Ce n'est (d'ailleurs) pas parce que nous trouvons plus facile de penser d'une manière particulière que c'est vrai en fait." Mais l'une des études du Dr Barrett, avec Emily Reed Burdett, suggérait déjà que les enfants de moins de cinq ans trouvaient plus facile de croire aux "propriétés surhumaines" et étaient facilement capables de penser religieusement.
Par exemple, dans un test, il était demandé aux jeunes si leur mère pouvait connaître le contenu d'une boîte fermée. Les enfants de trois ans semblaient croire que leur mère connaîtrait toujours le contenu, tout comme Dieu. Ce n'est qu'à l'âge de quatre ans que les enfants ont commencé à comprendre que leurs mères n'étaient pas omniscientes et omnipotentes, contrairement à Dieu. Les enfants arrivaient aussi à différencier les capacités de connaissance entre les dieux et d'autres humains et animaux, plus rapidement (d'ici 2 ans !) qu'ils ne pouvaient faire la distinction entre les autres humains et les animaux !
Interview de Justin Barrett - The Guardian 25 novembre 2008
"Les enfants croiront beaucoup de ce que leurs parents leur enseignent, mais pas tout. Essayez de convaincre un enfant qu'une tarentule est inoffensive, que le brocoli est un meilleur aliment pour lui que les chips, ou que Paul McCartney est un meilleur musicien que Miley Cyrus et vous n'arriverez probablement à rien. De même, les enseignants ont du mal à enseigner de nombreuses idées scientifiques telles que l'évolution par sélection naturelle ou que les objets solides tels que les tables sont presque entièrement composés d'espace. Les enfants apprennent des choses que leur esprit est à l'écoute pour apprendre plus facilement que des choses qui vont à l'encontre de cet accord naturel.
Les psychologues du développement ont fourni la preuve que les enfants sont naturellement réglés pour croire aux dieux d'une sorte ou d'une autre.
Les enfants ont tendance à voir les objets naturels comme conçus ou déterminés d'une manière qui va bien au-delà de ce que leurs parents enseignent, comme l'a démontré Deborah Kelemen (voir son article The New Scientist - The God issue : We are all born believers). Par exemple, les rivières existent pour que nous puissions y aller pêcher, et les oiseaux sont là pour être jolis.
Les enfants doutent que les processus impersonnels puissent créer un ordre ou un but. Des études sur les enfants montrent qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un, qui n'est pas quelque chose, soit derrière l'ordre naturel. Il n'est pas étonnant que Margaret Evans (The New Scientist op. cit.) ait constaté que les enfants de moins de 10 ans préféraient les récits créationnistes des origines des animaux aux récits évolutifs, même lorsque leurs parents et leurs enseignants approuvaient l'évolution. Le témoignage des autorités n'avait pas plus de poids pour inverser cette tendance naturelle.
Les enfants savent que les humains ne sont pas derrière l'ordre, donc l'idée d'un dieu (ou de dieux) créateur(s) a un sens pour eux. Les enfants ont juste besoin d'adultes pour préciser lequel.
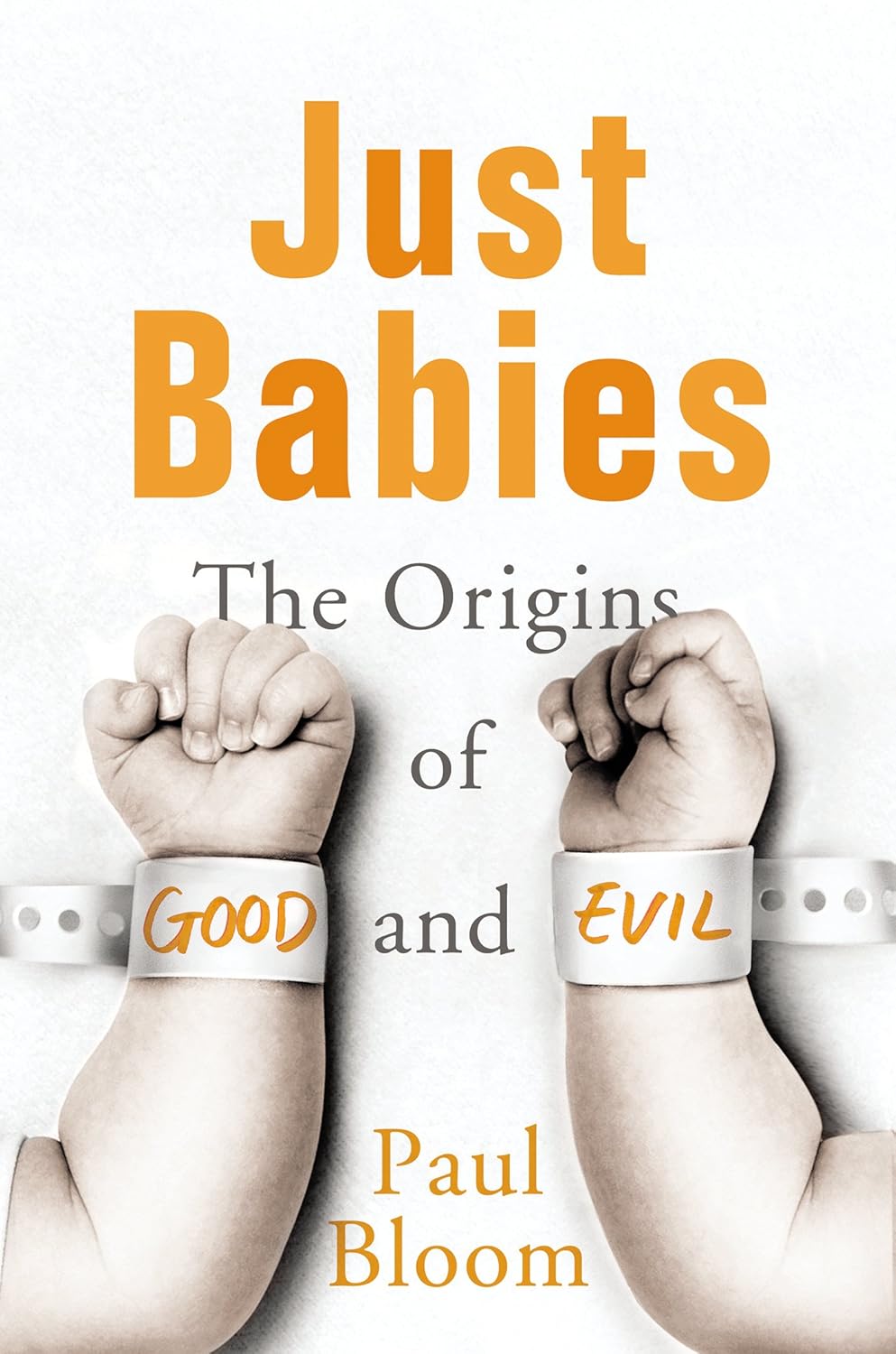
Des preuves expérimentales, y compris des études interculturelles, suggèrent que les enfants de trois ans attribuent des qualités super divines à de nombreux êtres différents. La superpuissance, la super-connaissance et la super perception semblent être des hypothèses par défaut. Les enfants doivent alors apprendre que la mère est faillible, et que le père n'est pas tout-puissant, mais aussi que les gens mourront. Les enfants peuvent donc être particulièrement réceptifs à l'idée d'un super créateur-dieu. Cela correspond à leurs prédilections.
Des recherches récentes de Paul Bloom, Jesse Bering et Emma Cohen suggèrent que les enfants peuvent également être prédisposés à croire en une âme qui persiste au-delà de la mort.
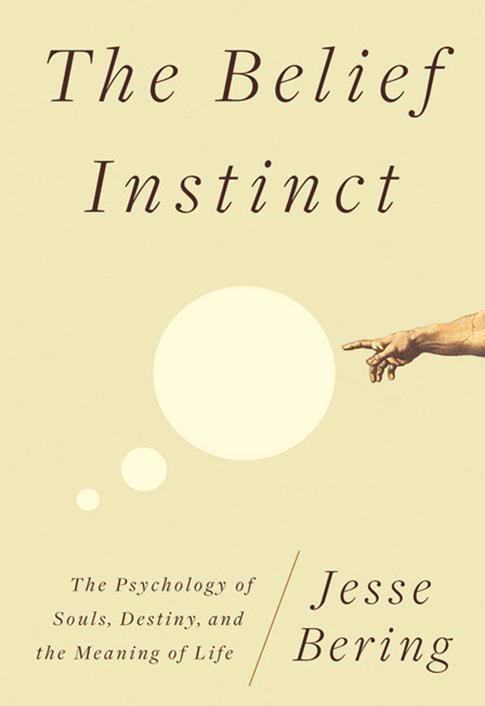
Cette croyance vient si naturellement aux enfants qu'elle peut autant prendre la forme d'une attaque contre la croyance religieuse (la croyance aux dieux n'est qu'un reste d'enfantillage) qu'à une promotion de la croyance religieuse elle-même (Dieu a implanté une graine pour la croyance dans les enfants). Ce sur quoi les deux parties devraient être d'accord, ce sont les preuves scientifiques : il est certain que les intrants culturels aident à remplir les détails, mais l'esprit des enfants n'est pas un terrain de jeu équitable. Ils sont inclinés dans le sens de la croyance."
Mais avec Born Believers, le Dr Barrett va beaucoup plus loin : en raison des caractéristiques uniques de l'esprit humain en développement, les enfants dès le plus jeune âge sont naturellement réceptifs à l'idée qu'il y a au moins un dieu, c'est-à-dire qu'ils sont des « croyants nés ». Certes, Barrett ne dit pas que les enfants naissent avec des théologies développées. Mais son point de vue est que, tout comme les êtres humains sont nés marcheurs et parlants, ils sont nés croyants. Aussi, avec une contribution culturelle et environnementale minimale, les enfants marcheront, parleront et croiront en un ou des dieux.
Discussion
Dans la première section du livre intitulé "The Evidence", Barrett offre son soutien à sa prémisse avec des résultats détaillés de recherches récentes en psychologie cognitive indiquant que les jeunes enfants ont tendance à voir l'ordre, le but et le design intentionnel dans le monde naturel. Ils voient également un designer, à qui ils attribuent la super connaissance, la super perception, le pouvoir créatif et l'immortalité. Barrett cite notamment des recherches de fond provenant de publications dans des revues à comité de lecture telles que Cognition, Developmental Psychology et Journal of Cognition and Development. Barrett explique en termes clairs et favorables aux laïcs, et interprète généralement les résultats avec des qualificatifs appropriés (« Cette réponse pourrait indiquer... » ; « Les enfants ont tendance à... » ; « Peut-être... » ; italique ajouté).
Une simple limitation est que certaines des études que Barrett cite n'ont été menées qu'avec des enfants issus de familles religieuses (96), une question méthodologique qui affaiblit certaines de ses conclusions. Barrett partage des recherches récentes qui reproduisent certaines des études dans des contextes non croyants, avec beaucoup des mêmes résultats. Cependant, Barrett lui-même indique que d'autres recherches sont nécessaires pour reproduire les études et enquêter davantage sur ses conclusions.
Dans la deuxième section du livre, "Les implications", Barrett répond aux contre-arguments à sa prémisse, y compris :
1) la croyance de l'enfance en Dieu est similaire à d'autres croyances infantiles normales dans des créatures magiques telles que le Père Noël
2) les enfants croyants sont simplement des enfants dont les parents les ont endoctrinés
3) l'existence de l'athéisme
Barrett aborde les deux premiers contre-arguments de manière convaincante et prudente.
Par exemple, Barrett aborde la charge d'endoctrinement de plusieurs façons : premièrement, en disant que les enfants n'acceptent tout simplement pas tout ce que les parents et les autres disent - certaines choses sont plus facilement enseignées que d'autres (par exemple, il est très difficile de convaincre un enfant que la boue gris-vert au potluck aura bon goût) - et deuxièmement, en offrant des exemples anecdotiques d'enfants d'athées qui semblent déterminés à croire malgré les meilleurs efforts de leurs parents.
En revanche, là où Barrett pourrait mieux faire, c'est dans l'existence d'enfants athés. Bien que Barrett affirme que l'athéisme en général est assez rare, et offre des données d'enquête indiquant que seul un Américain sur vingt ne croit pas en l'existence de Dieu, cette discussion se déroule dans le contexte des adultes. Cependant, la question pertinente à l'affirmation de ce livre serait : "Les enfants athées existent-ils ?" Bien que Barrett décrie des histoires puissantes d'enfants d'athées exhibant une foi forte et inexplicable en Dieu, leurs histoires sont simplement anecdotiques. Ces histoires soutiennent l'idée que l'endoctrinement n'est pas nécessaire pour croire en Dieu (un autre argument), mais Barrett n'offre aucune donnée concernant les jeunes enfants qui ne sont pas des "croyants nés", c'est-à-dire qui ne croient pas intuitivement en un ou des dieux.
Y a-t-il de tels enfants ? Barrett dit qu'il rencontre parfois des gens qui lui disent qu'ils ne se souviennent pas d'avoir jamais cru en Dieu. Son contre-argument est qu'un phénomène appelé amnésie infantile peut expliquer bon nombre de ces affirmations : "Je parie qu'une grande proportion de personnes qui pensent qu'elles n'ont jamais eu de croyances dans le surnaturel en fait l'ont fait et ont depuis oublié". Intéressant, mais faible contre-argument. Toutefois, dans l'ensemble, les affirmations de Barrett sont soutenables et convaincantes, en particulier pour ceux de la communauté croyante ; peut-être que les athées trouveraient les arguments moins convaincants.
Le travail de Barrett croise à certains égards un changement de paradigme qui a eu lieu dans le domaine de l'éducation chrétienne en général. Jusqu'à la dernière décennie environ, les éducateurs chrétiens utilisaient souvent le terme «développement de la foi» lorsqu'ils parlaient des enfants et de leur croissance dans la compréhension de la foi chrétienne. Pendant plusieurs décennies, l'éducation chrétienne a été fortement influencée par la théorie du "développement de la foi" de James Fowler qui, à son tour, s'est basée directement sur la théorie du développement cognitif de Piaget (ainsi que sur la théorie psychosociale d'Erikson). Le développement de la foi était considéré comme intrinsèquement lié à la possibilité pour un enfant de penser logiquement et (en fin de compte) de manière abstraite, une position qui a donné le sentiment que la foi des enfants est moins formée ou moins développée (que celle des adultes) jusqu'à ce qu'ils soient capables d'y penser de manière abstraite (vers l'âge de 11 ans environ).
En général, le domaine de l'éducation chrétienne se dirige vers la construction du développement spirituel des enfants, en particulier depuis le livre de Catherine Stonehouse Joining Children on the Spiritual Journey. Ce domaine s'éloigne de l'approche du développement cognitif de Piaget en tant que théorie de travail fondamentale, tout comme Barrett remet en question certains des principes de Piaget concernant les points de vue des enfants sur Dieu. Il y a aussi une acceptation plus large que les enfants sont des êtres spirituels dès la naissance, contrairement à l'idée qu'ils commencent ce voyage lorsqu'ils sont capables d'exprimer leur foi dans les doctrines de base. Une question clé parmi ceux qui promeuvent l'idée des enfants en tant qu'êtres spirituels dès la naissance : "Sur quelle base cette déclaration pourrait-elle être faite ?" Parmi les réponses : les enfants sont faits à l'image de Dieu, ou que lorsque Dieu a opéré le souffle de la vie, les humains sont devenus des êtres spirituels à partir de ce moment là. Le travail de Barrett pourrait contribuer à cette discussion.
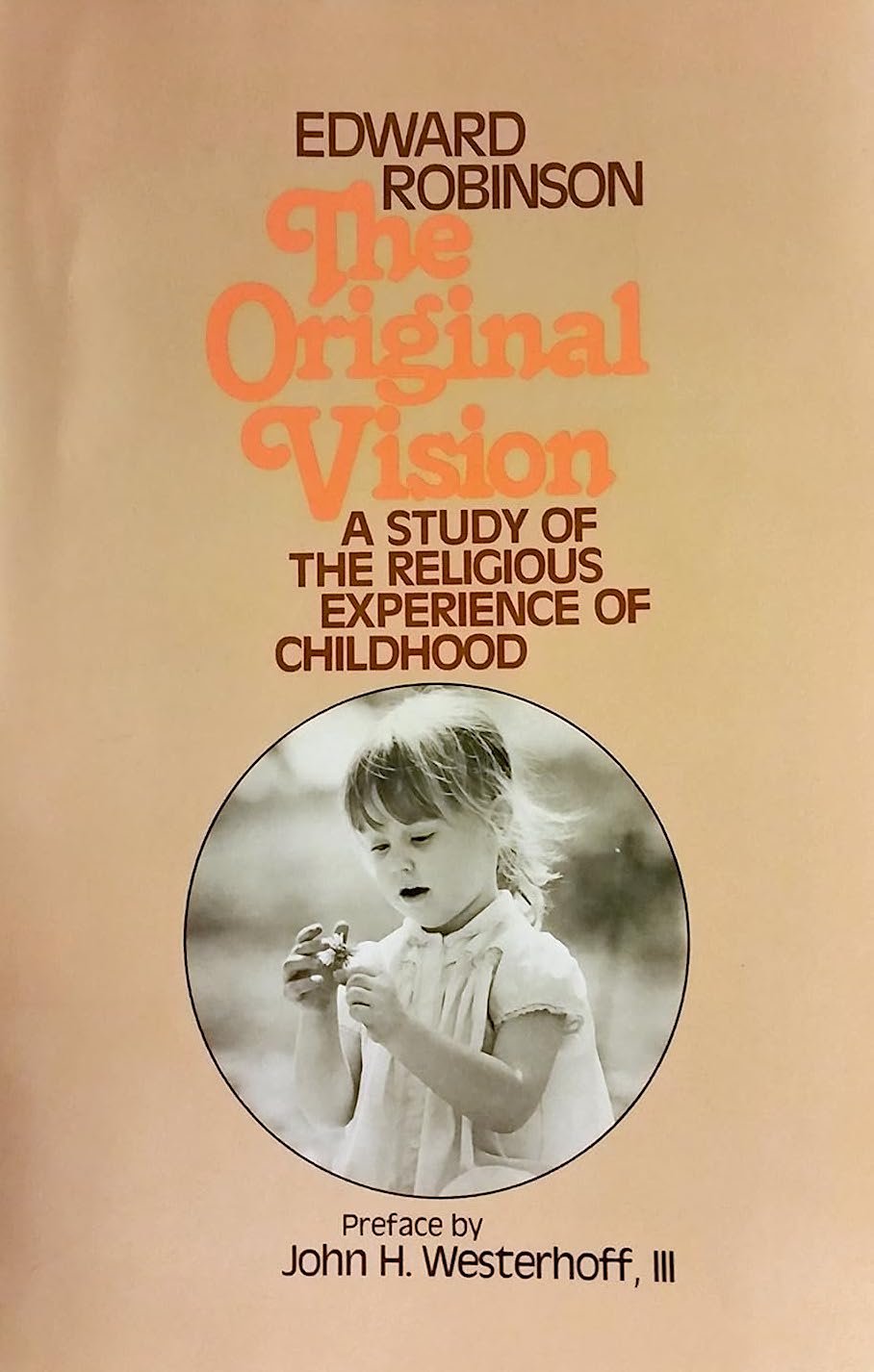
Certaines parties du livre de Barrett ressemblent aussi remarquablement à certaines des descriptions des recherches massives de Sir Alister Hardy au début des années 1970 au Royaume-Uni qui exploraient la signification des expériences religieuses chez 4 000 participants et le travail de suivi d'Edward Robinson dans The Original Vision (Nashville, TN : Seabury Press, 1983) qui examinait en particulier les 600 participants dont les expériences religieuses rappelées datent de l'enfance. Certaines de ces expériences ont été décrites par des participants qui n'ont revendiqué aucune influence religieuse (c'est-à-dire aucune affiliation à l'église et des parents non religieux, etc.) dans leur enfance, mais qui ont signalé un événement spirituel important et mémorable. Sofia Cavalletti rapporte plusieurs anecdotes similaires dans son œuvre puissante The Religious Potential of the Child (New York : Paulist Press, 1983) ; Cavalletti conclut que les enfants, même les très jeunes enfants, parlent de Dieu d'une manière qu'ils n'ont pas apprise, une conclusion avec laquelle Barrett résonnerait.
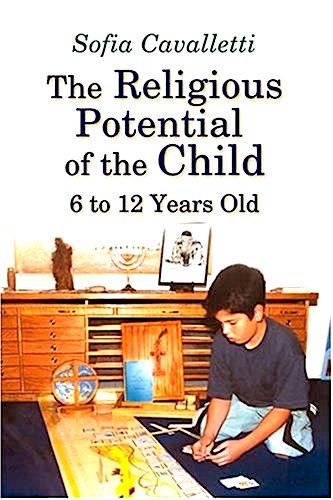
La recherche récente sur le cerveau fait également valoir certains travaux de Barrett. Par exemple, Andrew Newberg, expliquant que le cerveau remplit les blancs de notre compréhension, ajoute :
Je dirais que le cerveau est finalement une machine croyante ; il doit l'être. Il essaie de donner un sens au monde, et il rassemble une perspective sur notre monde, comble beaucoup de lacunes, ne prend pas la peine de nous le faire savoir, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous utilisons ces informations pour traverser nos vies comme si nous savions ce qui se passe.
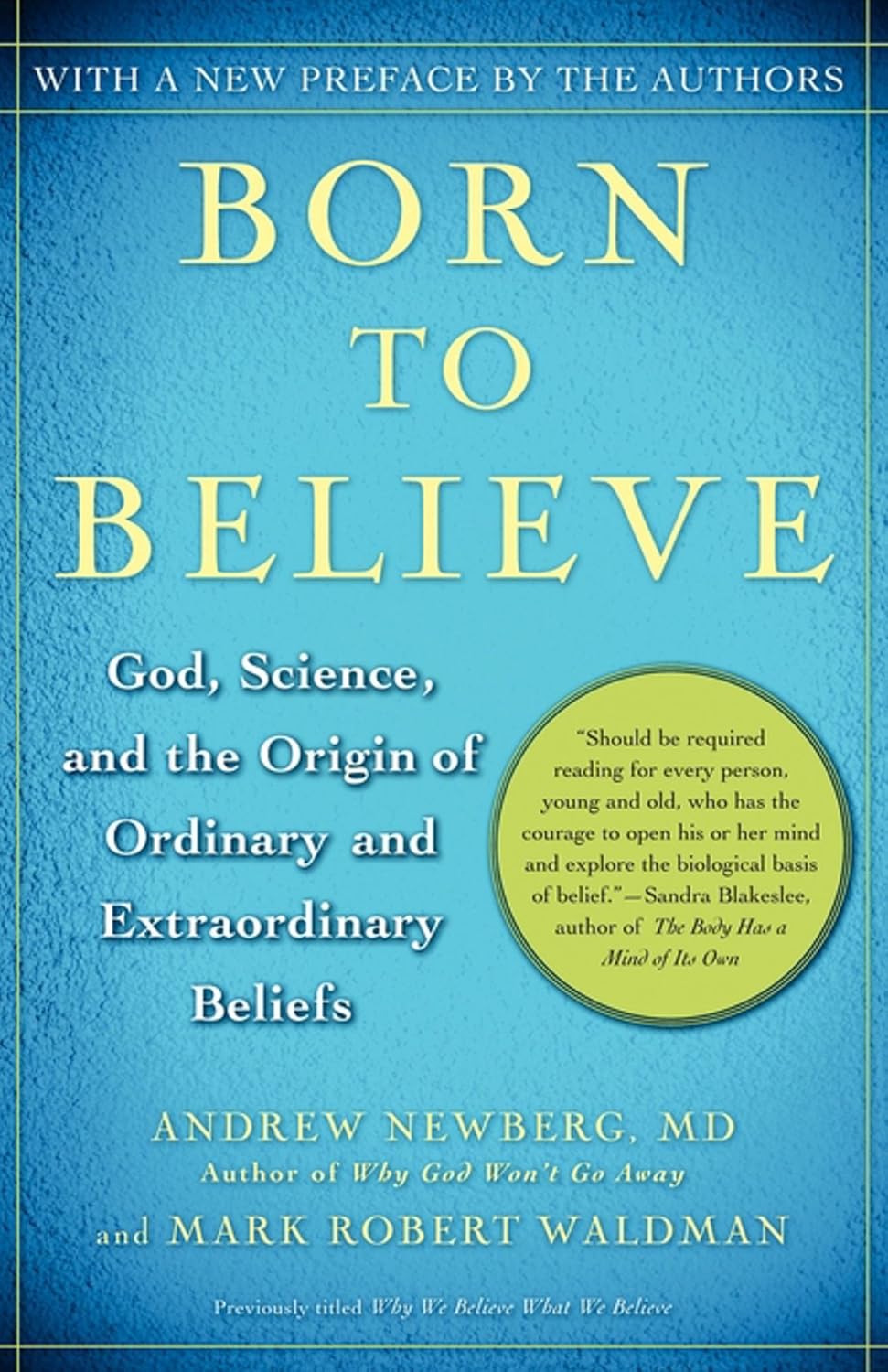
Finalement, alors que la majeure partie du livre Born Believers est construite autour des arguments de la croyance née, Barrett conclut par un chapitre intitulé "Encourager le développement religieux des enfants". Barrett, un chrétien employé par le séminaire Fuller, fait néanmoins très attention à ne pas promouvoir le christianisme en soi. Ainsi, son chapitre final, bien qu'il s'applique très bien aux parents chrétiens qui espèrent nourrir la croyance en leurs enfants, s'applique également aux parents dans d'autres contextes religieux.
Ainsi, bien que Barrett soit convaincu que les enfants soient nés croyants, il déclare dans une récente interview qu'"il y a une différence entre croire qu'il y a un dieu et avoir une relation avec ce Dieu. Cela nécessite une culture dont nous ne parlons pas dans la recherche sur les croyants nés." Et le chapitre 11 offre des recommandations bien réfléchies et nuancées pour les parents qui souhaitent cultiver le développement religieux de leurs enfants. Parmi les recommandations de Barrett, il y a : "commencer tôt et enseigner avec amour et humilité, enseigner comment penser, apprendre et discerner la vérité, parler de Dieu dans des contextes réels, dans lesquels l'action de Dieu peut être détectée, ou utiliser des idées religieuses dans des circonstances banales et pas seulement spéciales, et vivre ce que vous croyez."
Barrett clôt cette discussion avec l'humilité qui le caractérise dans son livre en général. Il reconnaît que même si les enfants peuvent avoir des tendances naturelles à croire en Dieu, et que les parents religieux peuvent suivre les directives qu'il suggère, les enfants peuvent ne pas devenir des adultes croyants. Barrett conclut : « Bien que les enfants puissent naître croyants, qu'ils meurent croyants, c'est entre eux et Dieu ».

